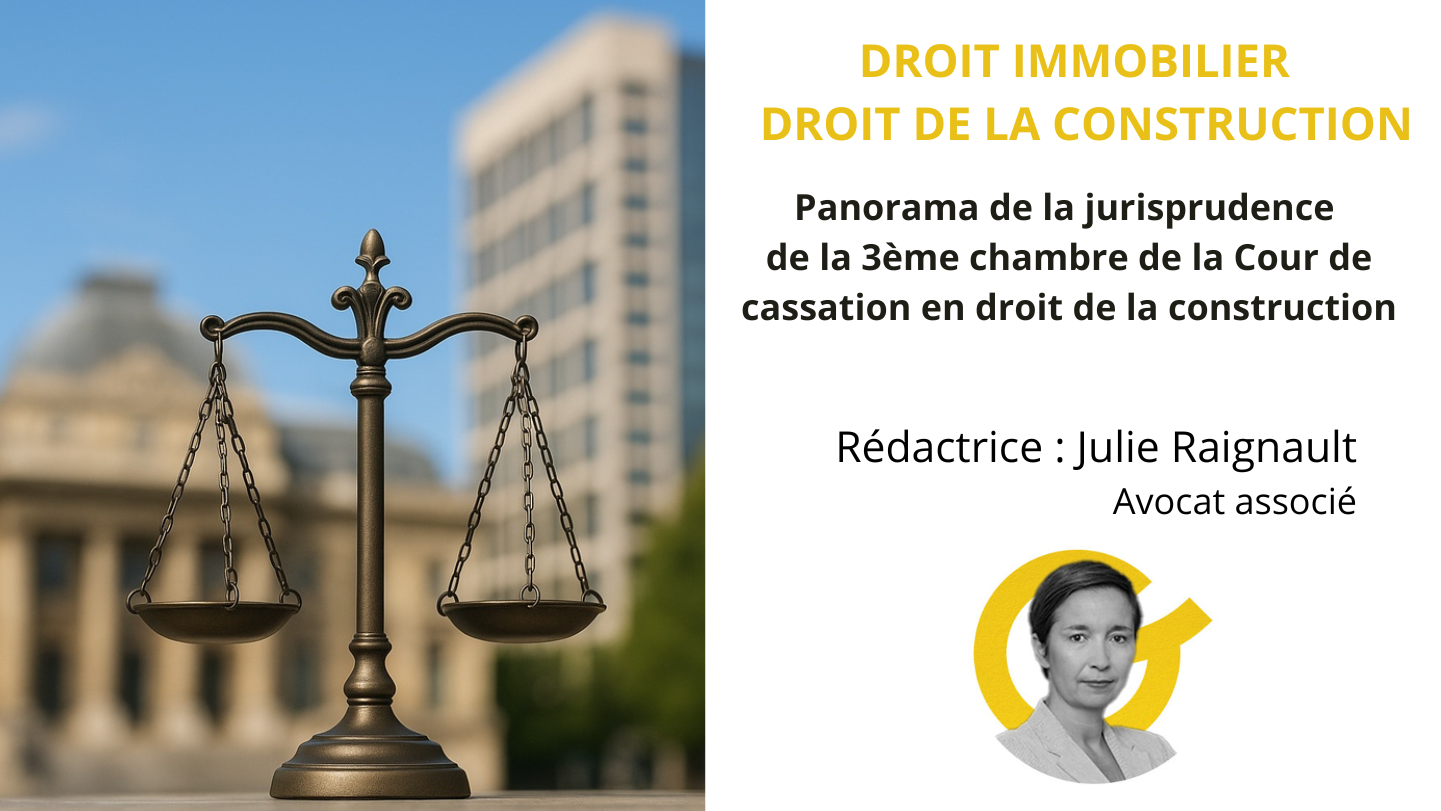
Panorama de la jurisprudence en Droit de la construction (janvier 2024 – juillet 2025)
Analyse de 18 mois de jurisprudence de la chambre de la construction de la Cour de cassation
⊕ Nous vous proposons une analyse des arrêts rendus par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en matière de droit de la construction, du mois de janvier 2024 au mois de juillet 2025. Ce panorama porte sur les différents aspects de cette matière soumis à notre plus haute juridiction civile, à l’exclusion des contentieux relatifs aux contrats de construction de maisons individuelles (CCMI).
⊕ Seules les décisions les plus instructives et importantes seront traitées ici, qu’elles aient ou non été publiées par la Cour dans son Bulletin.
⊕ Que vous soyez promoteur, architecte, entreprise de construction, maître de l’ouvrage ; que vous soyez ou non juriste, cette large sélection d’arrêts vous permettra de prendre connaissance des dernières évolutions de la jurisprudence de notre plus haute juridiction dans un domaine, le droit de la construction, en perpétuel mouvement.
⊕ Notre chronique récapitulative et analytique des arrêts les plus significatifs de la 3ème chambre vous permettra d’éclairer quelques zones grises que vous êtes parfois amenés à rencontrer sur vos chantiers ou dans vos dossiers.
⊕ En tant que professionnels du droit, notre rôle est aussi d’aider nos clients à comprendre le droit positif pour en faire un levier stratégique, sécuriser leurs projets, prévenir les litiges ou les résoudre par les voies les plus efficaces.
Sommaire :
1.1. Ouvrage neuf et ouvrage existant
1.2. Elément d’équipement
2.1. Clause pénale
2.2. Groupement momentané d’entreprises
2.3. Décompte Général Définitif
2.4. Révision de comptes
2.5. Travaux supplémentaires
2.6. Retard des travaux
3.1. Secteur protégé – Délai de rétractation
3.2. Vice caché et défaut apparent
3.3. Retard de livraison
5.1. Réception expresse
5.2. Réception tacite
5.3. Réception judiciaire
5.4. Levée des réserves
6.1. Caractère non apparent des désordres
6.2. Titulaire de l’action
6.3. Acception du risque par le maître de l’ouvrage
6.4. Caractère décennal du désordre
6.5. Imputabilité du désordre
6.6. Responsabilité du MOD
6.7. Désordre évolutif
6.8. Désordre hypothétique
7.1. Responsabilité contractuelle du constructeur
7.2. Responsabilité de la maitrise d’œuvre
7.3. Responsabilité de l’AMO
7.4. Responsabilité du géomètre-expert
8.1. En cas de mise en jeu de la responsabilité décennale
8.2. En cas de mise en jeu d’un autre régime de responsabilité
9.1. Assurance décennale
9.2. Assurance RC professionnelle de l’architecte
9.3. Appel en garantie et action récursoire
10.1. Prescription et forclusion
10.2. Expertise non judiciaire
10.3. Responsabilité de l’expert judiciaire
I. OUVRAGE
1.1. Ouvrage neuf et ouvrage existant
L’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que si deux conditions cumulatives sont réunies :
- une indivisibilité technique des deux ouvrages ;
- l’incorporation totale de l’ouvrage existant dans le neuf.
Ce sont les conditions posées par l’article L. 243-1-1 du code des assurances depuis juin 2005. Prenant acte de ce rétrécissement du champ des assurances obligatoires par rapport à la jurisprudence de la première chambre civile du 29 février 2000 (Cass. Civ. 1, 29 février 2000, n° 97-19.143, Bull. 2000, I, n° 65), la 3ème chambre rappelle le principe posé à l’article susvisé dans un arrêt publié du 30 mai 2024 en imposant aux juges du fond de caractériser l’existence de ces deux conditions (Cass. Civ. 3, 30 mai 2024, n° 22-20.711, publié).
1.2. Élément d’équipement
Élément d’équipement. La Cour de cassation jugeait depuis son arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640) que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La Cour de cassation jugeait depuis son arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640) que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Élément d’équipement.
La Cour de cassation jugeait depuis son arrêt du 15 juin 2017 (Cass. Civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640) que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Revirement de jurisprudence le 21 mars 2024 dans un arrêt didactique de la 3ème Chambre, qui explique les raisons de son revirement : la cour considère désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la seule responsabilité contractuelle de droit commun. Les hauts magistrats précisent que ce revirement est d’application immédiate (Cass. Civ. 3, 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié).
Dans une affaire jugée en fin d’année 2024, était soumise à la Cour une décision de la Cour d’appel de Rennes de 2022 qui avait fait application de la jurisprudence en vigueur depuis le 15 juin 2017 rappelée ci-avant. Les juges bretons ont été censurés par la Cour de cassation, qui a appliqué aux faits de l’espèce sa nouvelle jurisprudence du 21 mars 2024, dont les magistrats bretons ne pouvaient pourtant pas avoir connaissance en 2022 … Le revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 est donc bien d’application immédiate aux instances en cours (Cass. Civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-13.562).
Elément d’équipement professionnel. A la faveur d’une décision rendue le 6 mars 2025 et publiée au bulletin, la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 1792-7 du code civil, que les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage – ici un séparateur d’hydrocarbures traitant les eaux chargées de boues et hydrocarbures dans une société de lavage automobile – sont exclus du régime de la responsabilité décennale (Cass. Civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-20.018, publié).

II. MARCHE DE TRAVAUX
2.1. Clause pénale
Dans cette espèce, il avait été prévu dans la lettre de commande une clause pénale stipulant qu’en cas de retard de délivrance d’un ordre de service au-delà d’un délai de 180 jours, le contrat serait résilié et le maître de l’ouvrage devrait alors s’acquitter d’une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. La Cour d’appel a fait application de cette clause pénale dans le cas d’une résiliation du marché aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage pour non-paiement du prix des travaux. La Cour de cassation casse cette décision au motif que la clause pénale ne s’applique qu’au cas spécifiquement prévu au contrat, dans cette espèce la délivrance tardive de l’ordre de service n° 2 (Cass. Civ. 3, 3 octobre 2024, n° 23-12.536).
2.2. Groupement momentané d’entreprises
La Cour de cassation rappelle, dans une décision publiée du 19 septembre 2024, les contours de l’office du juge des référés et la faculté pour une entreprise membre d’un groupement solidaire ou conjoint d’agir en paiement contre le maître de l’ouvrage. Sur le premier point, la Cour confirme que le juge des référés est tenu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir quel que soit le caractère sérieux de la contestation opposée. Sur le second point, la 3ème chambre adopte une position semblable à celle déjà adoptée par le Conseil d’Etat en 2004 (CE 25 juin 2004, n° 250573) et reconnaît à chaque entreprise membre d’un groupement le droit de saisir le juge d’une demande en paiement, et ce même si un mandataire a été désigné par le groupement pour le représenter auprès du maître de l’ouvrage, sauf stipulation contraire figurant dans le mandat (Cass. Civ. 3, 19 Septembre 2024, n° 22-21.831, publié).

Vous êtes membre d’un groupement momentané d’entreprises, veillez à la rédaction de la convention de groupement qui vous lie aux autres membres. Sauf clause contraire, n’oubliez pas que vous bénéficiez du droit d’introduire une action en paiement à l’encontre d’un maître de l’ouvrage qui ne paye pas vos prestations.
2.3. Décompte Général Définitif (DGD)
Interprétation du CCAP. Norme NF P 03-001. Dans ce cas d’espèce portant sur l’interprétation d’une clause d’un CCAP dérogeant à la norme NF P 03-001, la Cour de cassation rappelle que l’interprétation de la Cour d’appel est souveraine. Elle avait en l’occurrence parfaitement retenu qu’aucune clause du CCAP ne permettait de considérer que le DGD notifié par le maître de l’ouvrage était définitif et empêchait l’entrepreneur de faire une demande de paiement. Elle retient aussi qu’il doit être fait application des conditions du CCAP au paiement complet de l’entreprise, lequel prévoyait comme condition la levée de toutes les réserves, même mineures (Cass. Civ. 3, 20 juin 2024, n° 23-10.111).
Norme NF P 03-001. La norme NF P 03-001 (version de décembre 2000) prévoit des procédures, notamment en matière de DGD, qui s’imposent aux parties si celles-ci s’y sont référées dans leur marché. En l’espèce, la sanction est sévère pour le maître de l’ouvrage qui n’a pas contesté le DGD notifié par l’entreprise dans le délai de 45 jours requis, mais lui a notifié qu’il refusait de l’examiner compte tenu des malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés. La Cour a considéré qu’il était dès lors présumé de manière irréfragable avoir accepté le mémoire définitif de l’entreprise. Il en est de même des réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires (ici des surcoûts engendrés par des retards), si le maître de l’ouvrage ne les conteste pas dans les formes et délais prévus par la norme (Cass. Civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-13.790).

Veillez à une rédaction rigoureuse et claire des conditions particulières des marchés de travaux, notamment lorsqu’il s’agit de déroger à une disposition de la norme NF P 03-001. N’omettez aucune disposition contractuelle relative au droit à paiement, à ses conditions et modalités. Le non-respect des conditions générales ou particulières peuvent avoir des conséquences irréversibles.
2.4. Révision de comptes
Par un arrêt du 30 janvier 2025 publié au bulletin, la 3ème chambre civile a considéré qu’une révision du solde du décompte n’est pas nécessairement limitée aux erreurs purement matérielles, mais peut concerner toute erreur dont l’entreprise ne pouvait avoir connaissance au moment des comptes (Cass. Civ. 3, 30 janvier 2025, n° 24-13.476 et 23-13.369, publié).

Vigilance et traçabilité sont essentielles. Constructeurs, si vous découvrez une erreur ou un oubli dans le décompte final que vous ne pouviez détecter à l’époque, n’hésitez pas à en demander la révision. Promoteurs et maîtres de l’ouvrage, ne considérez pas un décompte comme intangible : si une erreur non apparente à l’époque est révélée, elle peut justifier une révision, y compris à votre détriment. Veillez à conserver une documentation complète et à assurer un suivi rigoureux des situations, paiements et décomptes.
2.5. Travaux supplémentaires
Preuve du consentement. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé. La preuve du consentement au prix de travaux supplémentaires ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facture litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (Cass. Civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-14.705). Si le CCAP exige l’établissement d’un devis et d’un ordre de service signé du maître de l’ouvrage, les juges du fond ne peuvent qualifier de travaux supplémentaires ceux commandés par le maître d’œuvre sans que ces deux conditions soient réunies (Cass. Civ. 3, 19 septembre 2024, n° 23-12.183).

Constructeurs, avant d’exécuter des travaux non prévus au marché, assurez-vous d’obtenir un accord exprès, écrit et conforme aux exigences contractuelles (devis, OS signé…). À défaut, vous risquez de ne pas être payés. Promoteurs et maîtres de l’ouvrage, vérifiez que toute demande de travaux supplémentaires respecte strictement les modalités prévues au marché.
2.6. Retard des travaux
Absence de stipulation contractuelle. En l’absence de délai d’exécution spécifiquement indiqué dans le marché, le maître de l’ouvrage ne peut opposer à l’entreprise le planning prévisionnel mentionné dans les comptes-rendus de chantier, lequel était amené à être modifié et l’avait d’ailleurs été sans opposition de la part du maître de l’ouvrage, qui n’avait pas envoyé de mise en demeure d’achever l’ouvrage dans un délai déterminé. Sans envoi d’une telle lettre, sans demande d’exécution des travaux dans ledit délai devant une juridiction, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait à bon droit rejeté les prétentions du maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3, 5 septembre 2024, n° 22-20.630). La Cour a, à nouveau, statué dans le même sens le 6 mars 2025 (Cass. Civ. 3, 6 mars 2025, n° 22-16.539).

Si vous souhaitez faire valoir un retard, un planning mentionné dans un compte-rendu de chantier ne suffit pas : un délai clair doit être fixé par contrat, et une mise en demeure formelle est indispensable.
III. CONTRAT DE VEFA
3.1. Secteur protégé. Délai de rétractation
Le point de départ du délai de rétractation de 10 jours de l’acquéreur non professionnel en VEFA est le lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Les règles des articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 641 du code de procédure civile ne se cumulent pas comme le soutenait l’acquéreur qui pensait pouvoir gagner 24 heures (Cass. Civ. 19 décembre 2024, n° 23612. 652, publié).
3.2. Vice et défaut apparents
Inapplicabilité du délai de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Lorsque le vendeur d’un immeuble à construire s’engage à réparer des désordres apparents et réservés à la réception, le délai de forclusion d’un an prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil ne s’applique pas, la Cour considérant que l’action en exécution de l’engagement du vendeur se distingue de celle fondée sur les vices et défauts de conformité apparents. La Cour de Cassation ne dit pas quel est alors le délai de prescription applicable. A notre sens, il devrait être le délai quinquennal de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil (Cass. Civ. 3, 1er février 2024, n° 22-23.716).
Application de la loi dans le temps. Cette décision de principe publiée porte sur l’application dans le temps de la loi du 25 mars 2009 relative à la garantie des vices et défauts de conformité apparents. C’est avec cette loi que le législateur a élargi le champ d’application de la garantie des vices apparents pour y englober les défauts de conformité apparents, lesquels n’étaient pas traités par l’article 1642-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967. La question posée à la Cour de cassation tenait à la détermination des règles gouvernant les contrats de VEFA en cours au moment du litige mais conclus antérieurement au 25 mars 2009. La Cour considère que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » et qu’il en résulte que les dispositions de l’article 109 de la loi du 25 mars 2009 modifiant l’article 1642-1 du code civil sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l’état futur d’achèvement livrés après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 28 mars 2009. La garantie des vices et défauts de conformité apparents qui pèse sur le promoteur-vendeur constitue sans nul doute un effet légal du contrat de VEFA. Dans cette espèce, le syndic de copropriété ayant été mandaté pour recevoir la livraison des parties communes le 7 octobre 2011, il en a été exactement déduit par les juges du fond que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 était applicable aux désordres apparents à la réception, qu’il s’agisse de « vices de construction » ou de « défauts de conformité ». (Cass. Civ. 3, 23 mai 2024, n° 22-24.191, publié).
Article 1642-1 et responsabilité de droit commun. Dans un arrêt du 13 février 2025, La Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de VEFA : la garantie des vices construction et des défauts de conformité apparents prévue à l’article 1642-1 du code civil est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’action en indemnisation fondée sur cette garantie doit impérativement être engagée dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents – conformément à l’article 1648 du Code civil (Cass. Civ. 13 février 2025, n° 23-15.846 publié).
Forclusion de la demande principale et demande reconventionnelle. Dans une autre décision du 13 février, mais non publiée, la Cour a eu à traiter la question suivante : le caractère forclos de l’action de l’acquéreur fondée sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents lui interdit-il d’invoquer en défense – ici, il s’agissait de répondre à une demande reconventionnelle visant le paiement du solde du prix – le moyen fondé sur le droit commun des contrats tiré du défaut de levée de la réserve pour s’opposer au paiement du solde du prix ?
Selon la Cour de cassation, une forclusion en application de l’article 1648 alinéa 2 n’a pas d’incidence sur l’invocabilité et la recevabilité du moyen de défense fondé sur le droit commun des contrats, même si les deux moyens reposaient sur un même élément de fait (Cass. Civ. 3, 13 février 2025, n° 23-13.761).

L’acquéreur doit scrupuleusement vérifier les éventuels non-conformités et vices de construction apparents à la livraison et agir dans le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil. Le promoteur vérifiera, quant à lui, si ce délai pour agir a bien été respecté par l’acquéreur. Point de vigilance : La clause par laquelle le vendeur limite sa garantie des vices apparents aux désordres dénoncés par l’acquéreur dans le mois de la prise de possession est réputée non écrite.
3.3. Retard de livraison
Causes légitimes de retard. Défaillance. La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir considéré que le retard de livraison d’un appartement acheté en VEFA pour cause de défaillance d’une entreprise intervenant sur le chantier ne peut être considéré comme légitime que s’il s’agit d’une « véritable défaillance » qui entraîne « la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l’entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché ». Tel n’est pas le cas de simples retards, même prolongés, dans la réalisation des travaux. Dans cette espèce, le contrat de vente stipulait comme cause de retard légitime le « retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant) (Cass. Civ. 3, 2 mai 2024, 22-20.477).
Caractère non abusif de la clause de retard légitime. Dans deux décisions du 30 avril 2025, la Cour de cassation vient rappeler sa jurisprudence selon laquelle la clause, usuellement incluse dans les contrats de vente de biens en l’état futur d’achèvement, prévoyant des causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que des intempéries, la défaillance d’entreprises, la survenance de grèves ou encore le « fait du prince » tel que nous l’avons connus pendant la crise du Covid 19, n’ont ni pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une telle clause ne peut donc être considérée comme abusive au sens L. 132-1 du code de la consommation (Cass. Civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-21.499 et 23-21.500).

Il convient de veiller scrupuleusement à la rédaction des clauses légitimant certaines causes de retard de livraison d’un bien vendu en VEFA, tant sur les causes possibles de retard, que sur les modalités de mises en œuvre (durée de la suspension, moyens de preuve de la survenance de l’évènement prévu au contrat etc…). Il convient également, pour le promoteur, de se ménager les preuves de la survenance de ces causes de suspension et d’en informer au fil de l’eau les acquéreurs pour leur permettre de s’organiser en conséquence et de limiter leur éventuel préjudice.
IV. SOUS-TRAITANCE
Qualité de sous-traitant. Absence d’agrément et préjudice du sous-traitant en l’absence d’action directe et de nullité du contrat. Responsabilité du sous-traité pour les fautes du sous-traitant. Il a été considéré qu’une société chargée de l’évacuation, du transport et du traitement des terres excavées mettait en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la simple fourniture de bennes et à l’évacuation en déchetterie, comme le soutenait le maître de l’ouvrage, et qu’elle a été dès lors à bon droit considérée comme un sous-traitant au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975. Cette décision statue aussi sur la faute du maître d’œuvre, en précisant que si ce dernier n’a pas mis en demeure l’entreprise principale de présenter le sous-traitant, cela fait perdre à ce dernier le droit à l’action directe. La Cour donne aussi des précisions sur le préjudice que le sous-traitant peut réclamer au sous-traité. En l’absence d’annulation du contrat, le préjudice indemnisable ne peut être supérieur au prix convenu avec le sous-traité. Enfin, la Cour précise que si le sous-traité est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant, il n’a, en revanche, pas à répondre des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants, sauf stipulation contraire (Cass. Civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302, publié).
Caution. Délégation de paiement. Dans son arrêt du 7 mars 2024, la 3ème chambre a apporté des précisions relatives au préjudice subi par le sous-traitant qui, bien qu’ayant été agréé et ses conditions de paiement acceptées par le maître de l’ouvrage, ne dispose ni d’un cautionnement, ni d’une délégation de paiement. La Cour considère ici que le maître de l’ouvrage qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie de la fourniture d’une caution prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal (Cass. Civ. 3, 7 mars 2024, n° 22-23.309, publié).

Les relations de sous-traitance méritent la plus grande attention, dès leurs prémices, au moment de la rédaction du contrat, de la détermination des conditions de paiement et de garantie ou encore de l’agrément du sous-traitant. Le non-respect de la réglementation en vigueur et une méconnaissance de la jurisprudence applicable peuvent avoir des conséquences fâcheuses.
Date de délivrance de la garantie de paiement. Le 30 avril 2025, la Cour de cassation a clarifié des points essentiels concernant les contrats de sous-traitance et les garanties de paiement, entendant concilier le principe de la liberté contractuelle avec l’objectif d’ordre public de protection des intérêts financiers du sous-traitant. Dans cette espèce, les parties au contrat de sous-traitance avaient prévu que celui-ci ne serait formé qu’à compter de la date d’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. En application de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel avait exactement retenu que la délivrance d’une délégation de paiement concomitamment à l’agrément du sous-traitant et de ses conditions de paiement exclut la nullité du contrat, à condition que le sous-traitant n’ait pas commencé les travaux avant cette date. En l’espèce, toutes les conditions étaient réunies : le contrat n’était donc pas nul comme le soutenait le sous-traitant (Cass. Civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-19.086, publié).

En cas d’aménagement contractuel relatif à la fourniture de la garantie ou à la prise d’effet du contrat de sous-traitance, il convient d’être particulièrement vigilent quant au point de départ de l’exigibilité des obligations du sous-traitant. Il en va de la validité du contrat.
V. RECEPTION
5.1. Réception expresse
Les parties qui ont prévu expressément dans leur marché l’application de la clause du CCAP stipulant que « l’absence de notification d’un procès-verbal de réception constitue refus de réception » doivent la respecter. Les demandes adressées par l’entreprise au maître de l’ouvrage aux fins de notification du procès-verbal de réception étant restées sans réponse, le refus de réception des travaux visé par le CCAP est caractérisé selon la Cour de cassation (Cass. Civ. 3, 6 mars 2025, 23-19.170).

A nouveau, soyez attentifs aux stipulations contractuelles qui aménagent, le cas échéant, la procédure de réception.
5.2. Réception tacite
Ces derniers 18 mois ont apporté leur lot de jurisprudences sur les critères retenus par les juges du fond pour caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
A titre liminaire, rappelons que les critères habituellement retenus sont la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage jointe au paiement de l’intégralité ou de la quasi intégralité des travaux. Mais cela n’est pas si simple, et la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils exposent les éléments sur lesquels ils se fondent pour retenir ou non l’existence d’une volonté non équivoque de réceptionner (Cass. Civ. 3, 20 mars 2025, n° 23-20.475 ; Cass. Civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-19.248 ; Cass. Civ. 3, 5 septembre 2024, n° 23-18.751).
Ces derniers mois, la réception tacite a été retenue dans les cas suivants :
- Dans le cas d’un ouvrage existant, le seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux ne peut conduire à considérer qu’il a pris possession des lieux (Cass. Civ. 3, 23 mai 2024, n° 22-22.938, publié) ;
- Une prise de possession du bien et le paiement de la quasi intégralité du prix suffisent même lorsque le maître de l’ouvrage a formulé des réserves peu après la prise de possession, tenté d’obtenir la reprise des malfaçons et même cherché un logement de substitution en urgence compte tenu de la gravité des désordres (Cass. Civ. 3, 19 septembre 2024, n° 22-24.808) ;
- En cas d’abandon de chantier, la réception tacite par le maître de l’ouvrage n’est pas soumise à la constatation par le juge que le bien est habitable, seule suffit la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état, (Cass. Civ. 3, 6 juin 2024, n° 22-24.047) ;
- La prise de possession et la mise à bail immédiate du bien livré vaut acceptation sans équivoque de réceptionner l’ouvrage (Cass. Civ. 3, 7 novembre 2024, n° 22-22.793 et 23-18.548).
- La remise du vendeur aux acquéreurs des clefs d’une maison habitable, son électricité étant alimentée par un groupe électrogène installé et entretenu par le maître de l’ouvrage, doit être interprétée comme une réception tacite acceptée de manière non équivoque par le vendeur sans avoir à apprécier les conditions de la réception en la personne des acquéreurs (Cass. Civ. 3, 7 novembre 2024, n° 22-22.794 et 23-18.549) ;
- La signature d’un mandat de vente avec une agence immobilière établit suffisamment que les vendeurs avaient manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage à la date du mandat. (Cass. Civ. 3, 13 février 2025, 23-17.425).
A l’inverse, la réception tacite n’a pas été caractérisée dans les espèces suivantes :
- La volonté non équivoque de réceptionner les travaux ne peut se déduire du caractère habitable de la maison lorsqu’il en a été pris possession, alors que le maître de l’ouvrage a refusé par deux fois de procéder à la réception (Cass. Civ. 3, 6 juin 2024, n° 22-23.557).
- La réalisation d’un constat d’huissier faisant état d’un abandon de chantier, d’inachèvement et de non-façons à laquelle s’ajoutait une déclaration de créance, s’analysant, selon la cour d’appel, en une demande de paiement des travaux de reprise, ne peuvent pas caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon du chantier (Cass. Civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-13.283).
5.3. Réception judiciaire
Caractère habitable. Dans une décision du 19 septembre 2024, la Cour a rappelé la règle selon laquelle la réception judiciaire n’est prononcée que si l’ouvrage est en état d’être reçu, soit, pour une maison d’habitation, si celle-ci est habitable, et ce peu importe si le maître de l’ouvrage, à cette date, n’a même pas encore été convoqué pour procéder à la réception, et peu importe surtout la volonté ou l’absence de volonté de recevoir du maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3, 19 septembre 2024, n° 22-24.871, 23-10.105, 23-10.965).
Existence de contestations. Des contestations formulées par le maître de l’ouvrage après l’achèvement, portant dans cette espèce sur l’écroulement partiel d’un talus, ne sont pas de nature à empêcher le prononcé de la réception judiciaire (Cass. Civ. 3, 17 octobre 2024, n° 23-15.006).
Désordre affectant la solidité. L’existence de désordres affectant la solidité d’une charpente rend impossible sa réception (Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-14.407).
Réserves. La réception judiciaire peut être prononcée avec des réserves, et ce même lorsque le maître d’ouvrage s’est abstenu d’émettre la moindre observation à la date où l’ouvrage était en état d’être reçu ou ultérieurement, lors du paiement du solde. Lors d’une réception amiable, seuls les désordres expressément énoncés dans le procès-verbal sont considérés comme « réservés ». Tout autre désordre apparent non mentionné est alors purgé par la réception. À l’inverse, dans le cas d’une réception judiciaire, tout désordre apparent au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu peut être ultérieurement érigé en réserve, même s’il n’a pas été signalé sur le moment par le maître de l’ouvrage. Ce mécanisme peut être plus protecteur pour ce dernier, mais il faudra composer avec l’aléa judiciaire (Cass. Civ. 3, 30 janvier 2025, n° 23-13.369 et 23-13.476, publié).
5.4. Levée des réserves
La demande de condamnation formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur au titre de pénalité contractuelle de retard ne peut être accueillie lorsque le retard dans la levée des réserves n’est pas le fait du constructeur, mais résulte de la « mauvaise volonté » et de « l’obstruction » du maître de l’ouvrage. Il a aussi été considéré dans cette décision que les pénalités de retard dans la remise des DOE n’étaient pas dues au maître de l’ouvrage au motif que l’entreprise de construction produisait une attestation de son salarié ayant remis lesdits DOE en mains propres au maitre de l’ouvrage et un témoignage d’un tiers ayant assisté à cette remise en mains propres (Cass. Civ. 3, 3 avril 2025, 23-18.470).

VI. RESPONSABILITE DECENNALE
6.1. Caractère non apparent des désordres
Pour écarter la mise en jeu des garanties au titre de l’article 1792 du code civil, les juges du fond doivent déterminer qu’au moment de la réception le maître de l’ouvrage a pu constater le défaut de conformité ou le vice de construction et a pu appréhender toutes les conséquences du désordre (Cass. Civ. 3, 18 janvier 2024, 22-22.480).
Des désordres ayant fait l’objet, en cours de chantier, d’un protocole transactionnel aux termes duquel des travaux devaient être effectués et l’ont été, doivent être considérés comme des désordres apparents au moment de la réception. N’ayant pas fait l’objet de réserve, alors que le maître de l’ouvrage en avait connaissance dans toute leur ampleur, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre (Cass. Civ. 3, 5 septembre 2024, n° 23-11.077).
6.2. Titulaire de l’action. Preneur à bail
La décision du 1er février 2024, publiée surtout pour son volet relatif à l’appel en garantie formé contre l’assureur d’un tiers coresponsable du dommage (Cf. ci-dessous), est aussi intéressante sur le plan de la titularité de l’action en garantie décennale. La Cour de cassation casse ici un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers qui a condamné un assureur en responsabilité décennale à indemniser un preneur à bail des dommages immatériels consécutifs. La règle est connue, mais la Cour de cassation la rappelle : seul le maître de l’ouvrage ou la personne qui acquiert ses droits par transfert de la propriété peut agir en responsabilité décennale aux fins de réparation d’un dommage immatériel. Le preneur à bail ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun (Cass. Civ. 3, 1er février 2024, n° 22-21.025, publié).
6.3. Acceptation ou non du risque par le maître de l’ouvrage
Quelle est l’étendue de la responsabilité de l’architecte dont la mission était d’établir les documents du permis de construire en cas de désordres postérieurs dus à des problématiques de sols ? Dans cet arrêt, la Cour rappelle sa décision du 21 novembre 2019 (Cass. Civ. 3, 21 novembre 2019, n° 16-23.509) qui avait considéré qu’un architecte chargé d’un projet architectural au stade du permis de construire doit livrer un projet réalisable, et donc tenir compte des contraintes du sol. Alors qu’il était établi que l’architecte avait expressément conseillé à ses clients de réaliser une étude de sol, la Cour de cassation considère qu’il n’est pas établi que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté les risques et que les désordres de fissures en façade résultent de l’absence de prise en compte des contraintes de sol imputable à l’architecte. Le bureau d’études qui avait réalisé les plans de structure voit aussi sa responsabilité engagée, même s’il avait averti les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de dimensionner les fondations après réalisation d’une étude de sol. La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve au motif que le bureau d’études n’a pas démontré l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité (Cass. Civ. 3, 15 février 2024, n° 22-23.682).
Dans une autre affaire, jugée le 7 novembre 2024, la Cour de cassation a considéré à l’inverse que le maître de l’ouvrage avait délibérément accepté le risque de ne pas réaliser des études de sol avant la réalisation des travaux, alors que le contrôleur technique avait donné un avis défavorable. Cette acceptation délibérée du risque constitue une cause étrangère exonérant le constructeur de sa responsabilité décennale (Cass. Civ. 3, 7 novembre 2024, n° 22-22.794 et 23-18.549).
Le même jour, la Cour a jugé que l’acceptation « délibérée » du risque par le maître de l’ouvrage n’était pas discutable puisqu’il avait refusé de procéder à des études de sol contre l’avis du contrôleur technique, de telle manière que cette « cause étrangère » au sens de l’article 1792 du code civil devait exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale (Cass. Civ. 7 novembre 2024, n° 22-22.793 et 23-18.548).
6.4. Caractère décennal du désordre
Si la démolition et la reconstruction peuvent être jugées indispensables pour remettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, ce n’est pas pour autant que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination et que le désordre constaté a une nature décennale. La Cour de cassation rappelle ici qu’il convient en premier lieu d’analyser la nature des défauts de conformité et de rechercher la cause de la nécessité de démolition-reconstruction afin de déterminer si le désordre qui en est à l’origine relève ou non de l’article 1792 du code civil (Cass. Civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-11.336, publié).
6.5. Imputabilité du désordre décennal
Les constructeurs et le vendeur d’immeuble à construire ne peuvent engager leur responsabilité décennale que si les désordres relevés sont imputables aux travaux qu’ils ont réalisés ou fait réaliser. La Cour de cassation casse une décision de la cour d’appel de Paris qui avait jugé responsables au titre de l’article 1792 du code civil le vendeur et les locateurs d’ouvrage, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire, au motif que les nombreuses infiltrations affectant l’immeuble étaient dues à l’état général piteux de la toiture dont la charpente et les chevrons n’avaient reçu aucun traitement. La Cour aurait dû rechercher si les désordres avaient été causés ou aggravés par les interventions, même ponctuelles, ou s’ils étaient imputables à l’ouvrage existant (Cass. Civ. 3, 19 décembre 2024, n° 23-15.039).
6.6. Responsabilité du maître d’ouvrage déléguée
Dans un arrêt du 5 décembre 2024, La Cour de cassation redéfinit en profondeur le statut du maître d’ouvrage délégué, et potentiellement celui de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (Cf. ci-après). Traditionnellement considéré comme un prestataire ayant pour mission d’aider le maître d’ouvrage à remplir ses fonctions, et non comme un « constructeur » au sens de l’article 1792-1 du Code civil, le MOD est désormais qualifié par la Cour de « locateur d’ouvrage ». La mission de « superviser » le maître d’œuvre dans l’exercice de sa mission et de « veiller » à la conformité des travaux aux descriptifs et marchés doit semble-t-il conduire le MOD à l’obligation de souscrire une assurance décennale. Cette décision, rendue dans un contexte où le MOD ne jouait a priori qu’un rôle de contrôle et non de maîtrise d’œuvre, puisque dans l’espèce soumise à la Cour il y avait un maître d’œuvre, soulève des questions. Sans doute la Cour de cassation a-t-elle considéré que la mission confiée au MOD dépassait le cadre de ce type de prestation et empiétait sur celle d’un maître d’oeuvre, notamment en ce qu’elle visait la surveillance de « la bonne réalisation des travaux selon les descriptifs et marchés de travaux passés » et la « supervision » de ce dernier. (Cass. Civ. 3, 5 décembre 2024, n° 22-22.998).

Vous êtes MOD ou AMO, veillez à l’étendue de votre mission, même s’il y a un maître d’œuvre sur le chantier. Le cas échéant, prévoyez de souscrire une assurance décennale. Pour les autres intervenants, selon le rôle du MOD ou de l’AMO sur le chantier, ne négligez pas la possibilité d’engager sa responsabilité s’il a commis des fautes ayant participé à la survenance du dommage.
6.7. Désordre évolutif
Le délai décennal étant un délai d’épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs ne peut être engagée que pour les dommages dont il est établi qu’ils ont atteint, avant l’expiration de ce délai de forclusion, le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil (Cass. Civ. 3, 5 juin 2025, 23-20.379). Il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l’intérieur du délai décennal (Cf. Cass. Civ. 3, 28 février 2018, n° 17-12.460, Bull. 2018, III, n° 23).
6.8. Désordre hypothétique
Un risque de dommage n’est pas un dommage. Dans une décision publiée du 26 juin 2025, la Cour de cassation rappelle une condition essentielle de la garantie décennale : le dommage doit être actuel et réalisé dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Dès lors, le simple risque, même avéré, d’un dommage futur – tel qu’un risque d’inondation et d’injonction administrative aux fins de démolition ou de mise en conformité – ne constitue pas en un dommage relevant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil. Il est exigé par la Cour que l’inondation se soit effectivement produite ou que l’injonction ait été notifiée par les pouvoirs publics dans le délai décennal (Cass. Civ. 3, 26 juin 2025, n° 23-18.306, publié).
VII. AUTRES RESPONSABILITES
7.1. Responsabilité contractuelle du constructeur
Un arrêt inédit de la Cour du 16 janvier 2025 nous indique que si le constructeur est tenu de réaliser des travaux conformes aux prescriptions applicables en matière d’isolation phonique des bâtiments (article L. 111-11 du CCH devenu L. 124-4), aucune disposition légale ne lui impose de remettre au maître de l’ouvrage un bilan phonique de celle-ci. La seule obligation du constructeur, dans le cadre d’une construction de logements ou de travaux sur existants, consiste en la transmission d’une attestation acoustique à l’autorité qui a délivré le permis de construire (Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-16. 946).

Le propriétaire qui dispose d’éléments tangibles permettant de douter du respect de la réglementation acoustique sera bien avisé de solliciter la désignation d’un expert judiciaire acoustique au contradictoire des constructeurs concernés et de l’entreprise qui a délivré l’attestation acoustique contestée.
7.2. Responsabilité du maitre d’œuvre
Responsabilité du maître d’œuvre. Sous-traitant non agréé. Le maître d’œuvre, chargé d’une mission de surveillance du chantier, a l’obligation contractuelle d’informer le maître de l’ouvrage de la présence d’un sous-traitant et doit lui conseiller de se le faire présenter afin, le cas échéant, de l’agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations. S’il manque à ces obligations, le maître d’œuvre engage également sa responsabilité à l’égard du sous-traitant, sans pouvoir se retrancher derrière l’imprudence du sous-traitant, qui n’a pas l’obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage (Cass. Civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-18.244 et 22-19.434).
Architecte. Mission complète. Dans cet arrêt publié, la Cour clarifie la portée des obligations contractuelles intrinsèques à une mission complète, et tend à alourdir le champ de l’obligation de résultat pesant sur l’architecte. Un architecte chargé d’une mission complète est nécessairement chargé du mesurage des surfaces, lequel relève de la direction de l’exécution des travaux et de la surveillance de l’exécution de ceux-ci conformément aux prévisions contractuelles et aux plans établis. Une mission spécifique n’est pas requise. Dans ce cas de figure, la Cour de cassation considère que le maître de l’ouvrage peut réclamer, au titre de la perte de chance, le manque à gagner résultant de la non-conformité de l’ouvrage et donc le remboursement d’une partie du prix de vente sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (Cass. Civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-12.315, publié).
Obligation de conseil. Obligation de s’informer. La Cour considère qu’il n’appartient pas au maître de l’ouvrage d’informer le maître d’œuvre de l’exacte finalité d’utilisation du bâtiment à construire, mais aux maîtres d’œuvre – de conception et d’exécution – « de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu’ils acceptent de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l’ouvrage les aménagements adaptés à son projet » (Cass. Civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-11.668).

La tendance de la jurisprudence est à l’élargissement de la responsabilité des maîtres d’œuvre. Veillez à anticiper, alerter, conseiller et formaliser.
7.3. Responsabilité de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Si les désordres dénoncés ne présentent pas de caractère décennal, la responsabilité de l’AMO peut alors être recherchée sur le fondement contractuel, au même titre que tout autre constructeur et selon le régime juridique qui leur est applicable. C’est précisément ce qui a été retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2025. De manière très rigoureuse et particulièrement sévère pour les AMO, la Cour a considéré que l’AMO qui a reçu la mission d’assister le maître de l’ouvrage lors de la mise au point et de l’exécution du marché pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux, qui a participé aux choix des enduits et qui n’ignorait pas en conséquence l’importance de leur composition pour éviter l’apparition de fissurations, a manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage en ne vérifiant pas que le produit finalement appliqué n’en contenait pas, et qu’il n’était dès lors pas adapté (Cass. Civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-21.080).

AMO et MOD, il convient d’être vigilant. Même si vous n’êtes en principe pas considérés comme faisant partie de la maîtrise d’œuvre, votre responsabilité semble être de plus en plus facilement retenue par les juges, qui n’hésitent pas à vous considérer comme de véritables locateurs d’ouvrage susceptibles d’engager leur responsabilité décennale. La souscription d’une assurance décennale doit être envisagée selon les termes de votre mission. Pour rappel, la Cour de cassation a déjà requalifié un contrat d’AMO en contrat de maîtrise d’œuvre et condamné in solidum l’AMO sur le fondement de la responsabilité décennale (Cass. Civ. 3, 13 avril 2023, n° 22-11.024).
7.4. Responsabilité du géomètre-expert
Dans un arrêt du 4 avril 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un géomètre-expert qui dépose une demande de permis d’aménager non conforme au POS alors en vigueur commet une faute quand bien même ce POS serait annulé ultérieurement. La Cour de cassation rappelle ainsi que la faute du géomètre s’apprécie à la date de l’exécution de sa mission. La faute était ainsi caractérisée du fait que la demande déposée par le géomètre n’était pas conforme à son obligation « d’épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées »,peu important que l’article UC 9 ait fait l’objet d’une annulation ultérieure. En raison de cette faute du géomètre-expert dans la fixation des surfaces d’emprise au sol, la Cour a ensuite considéré que la demanderesse d’un permis d’aménager un lotissement a subi un préjudice au moment de la vente des lots. La Cour de cassation rappelle que ce préjudice s’analyse en une perte de chance correspondant à « une fraction des différents chefs de préjudices subis », laquelle est déterminée « en mesurant la chance perdue ». Les hauts magistrats estimé que sans la faute du géomètre, son client avait 40 % de chance d’éviter la perte correspondant en la différence entre le prix de vente demandé et le prix de la vente finalement obtenu (Cass. Civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-18.509 et 22-18.511 publié au Bulletin).

Géomètres-experts, avant tout dépôt de permis d’aménager, assurez-vous que le projet respecte pleinement le droit de l’urbanisme en vigueur à la date de la demande. Toute non-conformité, même à une règle ultérieurement annulée, constitue une faute engageant votre responsabilité. Maîtres de l’ouvrage, soyez vigilants quant à la conformité urbanistique des dossiers déposés par vos prestataires : une erreur de leur part peut faire perdre de la valeur à votre opération. N’hésitez pas à solliciter une analyse juridique complémentaire.
VIII. PREJUDICE REPARABLE
8.1. Dans le cas de la mise en jeu de la responsabilité décennale
Réparation intégrale. L’entrepreneur dont la responsabilité décennale a été retenue doit une réparation intégrale au maître de l’ouvrage même si cette réparation la conduit à prendre en charge financièrement des travaux de reprise qui ne sont pas directement en lien avec l’objet de son marché. Dans cette espèce, une entreprise chargée d’un drainage périphérique a dû reprendre ce drainage, mais aussi la mise en place remblais de comblement et le traitement des remontées capillaires des murs (Cass. Civ. 3, 21 novembre 2024, n° 23-13.989).
Choix des modalités de réparation. Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation vient rappeler le principe selon lequel, en application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose (Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, pourvoi n°23-17.265, publié).
8.2. Dans le cas de la mise en jeu d’un autre régime de responsabilité
Responsabilité contractuelle. Principe de proportionnalité. En l’absence d’autre solution technique de nature à permettre de rendre l’immeuble conforme à la réglementation (ici les règlementations incendie et accessibilité), une demande d’indemnisation correspondant au coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage ne peut être considérée comme disproportionnée (Cass. Civ. 3, 5 septembre 2024, n° 21-21.970).

IX. ASSURANCE
9.1. Assurance décennale
Mise en jeu de la garantie décennale. Position irrévocable de l’assureur. Dans un arrêt du 3 avril 2025 publié au Bulletin, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’assureur ne peut contester le principe de sa garantie et doit financer les travaux nécessaires s’il a pris position pour la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours prévu à l’article L. 241-1 du code des assurances. L’engagement explicite d’indemniser pris par l’assureur en application de cette disposition légale est irrévocable. En conséquence, l’assureur ne plus invoquer le caractère non décennal de certains dommages, ici découvert au cours d’une expertise judiciaire (Cass. Civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-16.055, publié).
Conséquences du caractère obligatoire et d’ordre public de l’assurance décennale. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2025 illustre parfaitement les conséquences sur le plan civil du défaut d’assurance décennale du constructeur. La Haute juridiction rappelle que l’absence de justification d’une assurance décennale est un manquement grave qui peut justifier la résiliation du marché aux torts exclusifs du constructeur et, en conséquence, sans indemnité (Cass. Civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-21.574).

Si vous êtes constructeur, veillez à vous assurer en déclarant l’ensemble des activités concernées. Si vous contractez avec un constructeur et rencontrez des difficultés avec une entreprise pour obtenir son attestation d’assurance décennale, vous pouvez le mettre en demeure de saisir le Bureau Central de Tarification (BCT).
9.2. Assurance RC professionnelle de l’architecte
Dans un arrêt inédit du 19 décembre 2024, la Cour de cassation revient sur la frontière entre la clause « objet du contrat » d’assurance et celle relative aux exclusions de garantie dans une espèce où la police d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte était mise en œuvre. L’enjeu est évidemment significatif puisque les clauses d’exclusion sont encadrées par les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Dans cette affaire, la Cour a considéré que la police devait couvrir le sinistre, peu important que les fautes retenues contre ce dernier « caractérisent des manquements à ses obligations déontologiques », lesquels « constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l’assureur invoquait une exclusion de garantie » et non un cas de non-garantie (Cass. Civ. 3, 19 décembre 2024, 23-13.820).

Que vous soyez l’architecte ou son client victime d’une faute de sa part, une lecture attentive et avisée des clauses d’une police d’assurance peut vous permettre de contraindre la compagnie d’assurance de couvrir le sinistre déclaré.
9.3. Appel en garantie et action récursoire
Action en garantie d’une entreprise responsable contre l’assureur du co-responsable. On savait déjà que le tiers lésé pouvait agir directement contre l’assureur de l’entreprise responsable sans avoir à mettre préalablement en cause l’assuré responsable. La Cour de cassation nous dit dans cette décision de principe qu’il y a lieu de statuer dans le même sens lorsque l’action exercée est un appel en garantie formé par le responsable des dommages : la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (Cass. Civ. 3, 1er février 2024, 22-21.025, publié).
Action récursoire. Prescription. L’action récursoire d’une entreprise jugée responsable contre l’assureur de responsabilité du coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable, soit par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, et ce même si l’assureur recherché n’est plus exposé au recours de son propre assuré en raison de l’expiration du délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances (Cass. Civ. 3, 7 mars 2024, 22-20.555).
Appel en garantie. Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre partie ou un tiers en garantie des condamnations prononcées à son encontre sans qu’il soit nécessaire que l’appelant en garantie ait préalablement indemnisé le demandeur initial. Le régime de l’appel en garantie est donc à distinguer de celui du recours subrogatoire, lequel requiert l’indemnisation préalable de la victime (Cass. Civ. 3, 17 octobre 2024, n° 23-14.113).

Recours en garantie ou subrogatoire, les conditions ne sont pas les mêmes. Veillez à ce qu’elles soient bien toutes réunies pour que vos actions soient efficaces.
X. PROCEDURE
10.1. Prescription et forclusion
Point de départ. VEFA. Investissement immobilier locatif défiscalisant. La Cour a considéré que le délai de prescription de 5 ans de l’action d’un acquéreur mécontent de la rentabilité de son investissement immobilier défiscalisant contre le vendeur de l’appartement et le banquier prêteur sur le fondement de l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde a pour point de départ, non pas le jour de la signature du contrat de vente, mais le jour où le risque s’est réalisé. Elle a jugé que le risque se réalise lorsque l’acquéreur apprend qu’il sera dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté. En l’espèce, l’achat du bien était assis sur un emprunt dont le remboursement du capital était différé à 10 ans, de telle manière que, même si la Cour ne se prononce pas sur le point de départ exact à retenir, on peut imaginer qu’il correspondra à l’issue de la période de défiscalisation et/ou au moment où l’acquéreur pourra remettre son bien en vente (Cass. Civ. 3, 1er février 2024, n° 22-13.446, publié).
Point de départ. Référé-expertise. Maître d’œuvre. Alors qu’un rapport d’expertise judiciaire avait imputé la responsabilité de désordres à deux sociétés, les juges du fond, 6 ans plus tard, ont écarté la responsabilité desdites sociétés et retenu celle de l’entreprise principale et de l’un de ses sous-traitants. Moins d’un an après la décision des juges du fond, les deux maîtres d’œuvre ont assigné ces deux dernières entreprises en réparation de leur préjudice. Leur action a été jugée prescrite par la Cour d’appel et la Cour de cassation au motif que les maîtres d’œuvre, à la date du rapport d’expertise, avaient connaissance de l’étendue de leur préjudice et étaient en mesure d’identifier toutes les entreprises impliquées dans la réalisation du sinistre au sens de l’article 2224 du code civil (Cass. Civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10.514).
Point de départ. Recours entre constructeurs. Rappelant sa jurisprudence du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305), la 3ème chambre précise à nouveau qu’une assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action d’un constructeur tendant à être garanti par un autre constructeur. L’assignation en référé-expertise délivrée par un maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une telle demande de reconnaissance d’un droit, ne fait pas courir ce délai de prescription de l’action en garantie de cet entrepreneur contre d’autres constructeurs. Le point de départ retenu par la Cour de cassation est la date de l’assignation au fond en indemnisation des préjudices (Cass. Civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-13.371 et n° 23-12.449 ; dans le même sens : Cass. Civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-15.701).
Point de départ. Délai. Recours entre constructeurs. La 3ème chambre de la Cour a fait ici une application intéressante des principes déjà connus en matière de recours entre constructeurs (et rappelés ci-dessus) en décidant que la recevabilité de ces recours ne dépend pas de celle de l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommage-ouvrage à leur encontre. Même si la seconde est prescrite, les recours entre constructeurs peuvent demeurer recevables (Cass. Civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-11.746). Cette décision inédite est à rapprocher de celle rendue par la chambre mixte 15 jours plus tard qui rappelle avec force les principes posés par la 3ème chambre dès le 16 janvier 2020 fondés sur la différence d’objet entre l’action principale du maître de l’ouvrage et les actions récursoires des constructeurs entre eux (Chambre mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23.527, publié).
Point de départ. Action du maître de l’ouvrage contre le fabricant. Manquement à l’obligation d’information. Vices cachés. Délai butoir. S’agissant de l’action directe du maître de l’ouvrage contre le fabricant fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil, la Cour rappelle que le point de départ du délai de prescription est la date de la livraison. S’agissant du délai biennal de l’article 1648, la Cour se saisit d’office, et rappelle que pour les actions en garantie des vices cachés introduites après la réforme du 17 juin 2018 à raison de contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription est de 2 ans sans pouvoir dépasser le délai-butoir de 20 ans. A noter que ce dernier ne s’applique qu’aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi si le délai de prescription décennal de l’article L. 110-4 ancien du code de commerce n’était pas expiré à cette date (Cass. Civ. 3, 3 octobre 2024, n° 22-22.792).
Suspension. Garantie des vices cachés. La première chambre de la Cour reprend ici le principe selon lequel le délai biennal de garantie des vices cachés est un délai de prescription (et non de forclusion – Cf. les 4 arrêt de la Chambre mixte du 21 juillet 2023) susceptible de suspension pendant la période d’expertise judiciaire entre la date de l’ordonnance désignant l’expert et la date du rapport d’expertise. Il convient de ne pas oublier que cette suspension profite au demandeur et non au défendeur qui n’a pas, lui-même, suspendu le délai de prescription (Cass. Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-14.650, publié[1]).
Point de départ. Recours du responsable en l’absence d’action judiciaire du tiers lésé. L’action en garantie des vices cachés engagée par l’entrepreneur ou son assureur contre le fournisseur ou l’assureur de ce dernier, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé, a pour but de faire supporter au fournisseur la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. Par conséquent, cette action ne se prescrit pas à compter de la découverte du vice, mais à partir de l’assignation en responsabilité du constructeur ou, à défaut, de l’exécution de son obligation à réparation. La solution retenue par la 3ème chambre Cour de cassation se place donc dans la continuité de l’arrêt de la chambre mixte du 19 juillet 2024 précité (Ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729). Elle favorise le règlement amiable des litiges en évitant de faire courir la prescription à une date obligeant les parties à exercer des actions judiciaires conservatoires (28 mai 2025, n° 23-18.781).
Assignation aux fins de jugement commun et opposable. Effet interruptif. Dans une décision publiée du 26 juin 2025, la Cour de cassation est venue préciser qu’une assignation en référé délivrée à la seule fin qu’un jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à une autre partie (ici, un fournisseur) a un effet interruptif de prescription à son égard, dès lors qu’il s’agit d’une demande en justice (Cass. Civ. 3, 26 juin 2025, n° 23-20.274, publié).
[1] Nous citons exceptionnellement cette décision de la 1ère chambre, et non de la 3ème comme toutes les autres, car elle concerne le domaine de la construction et a été publiée.

En matière de construction, la maîtrise des délais de prescription et de forclusion constitue un levier stratégique essentiel pour la bonne fin des dossiers. Trop souvent, des droits légitimes ne sont plus opposables car prescrits. La difficulté est d’autant plus grande que la prescription en droit de la construction est tout sauf uniforme, qu’il s’agisse des délais (1, 2, 5 ou 10 ans), des points de départ ou encore des modalités de suspension et d’interruption desdits délais. Face à cette complexité, nous recommandons aux acteurs de la construction d’intégrer, dès l’origine du projet, une gestion rigoureuse et anticipée des délais applicables à leurs droits comme à leurs obligations.
10.2. Expertise non judiciaire
Dans deux arrêts des 16 janvier et 30 avril 2025, la Cour de cassation revient sur la valeur d’une expertise amiable dans le cadre d’un litige de construction.
Dans sa décision du 30 avril, la Cour rappelle le principe que l’expertise amiable n’est prise en considération par les juges que si elle est corroborée par d’autres pièces du dossier (Cass. Civ. 3, 30 avril 2025, n° 23-18.729).
Dans la première affaire qui lui était soumise, objet de son arrêt du 16 janvier, deux rapports d’expertise amiable avaient été réalisés par deux experts distincts à la demande du demandeur. La Cour a rejeté le pourvoi et considéré que les juges du fond n’avaient pas violé le principe de la contradiction puisque les deux rapports d’expertise se corroboraient l’un l’autre et qu’ils étaient en adéquation avec un devis d’entreprise annexé à l’un des deux rapports. Les conclusions concordantes des deux rapports, confirmées par un devis d’entreprise, suffisaient à établir la pertinence de la solution réparatoire proposée et son coût (Cass. Civ. 3, 16 janvier 2025, n° 23-15.877).

Si l’expertise n’est pas judiciaire, faites en sorte qu’elle soit malgré tout contradictoire. En toute hypothèse, il est indispensable de disposer de pièces venant corroborer les constats et l’avis de l’expert privé que vous aurez mandaté (étude technique et devis par exemple). Mieux encore, une seconde expertise non contradictoire allant dans le même sens que la première viendra renforcer l’avis technique dont vous entendez vous prévaloir.
10.3. Responsabilité de l’expert judiciaire
Dans une décision du 19 mars 2025, la Cour de cassation précise que l’expert judiciaire engage sa responsabilité en raison des fautes commises dans l’exercice de sa mission conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Dans cette espèce, c’est le caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l’expert, « non étayées par des investigations sur la cause des désordres », qui a conduit la Cour à retenir sa responsabilité (Cass. civ. 1ère, 19 mars 2025, n°23-17.696).

Si vous êtes partie à une expertise judiciaire, nous vous recommandons d’être particulièrement attentif au déroulement des opérations et de transmettre vos observations si le rapport vous semble incomplet ou contestable.
Une compréhension fine et actualisée de la jurisprudence en matière de construction constitue un atout décisif pour anticiper les risques, sécuriser les contrats et défendre efficacement les intérêts des différents intervenants à l’acte de construire.
Les avocats du cabinet GRAMOND mettent leur expertise en droit de la construction et en responsabilité civile à votre service pour analyser vos projets, évaluer vos risques et bâtir des solutions juridiques adaptées à vos besoins.
Notre équipe dédiée vous accompagne dans la prévention des litiges comme dans leur règlement, afin de sécuriser vos opérations immobilières et garantir la pérennité de vos projets dans un environnement juridique en constante évolution.






