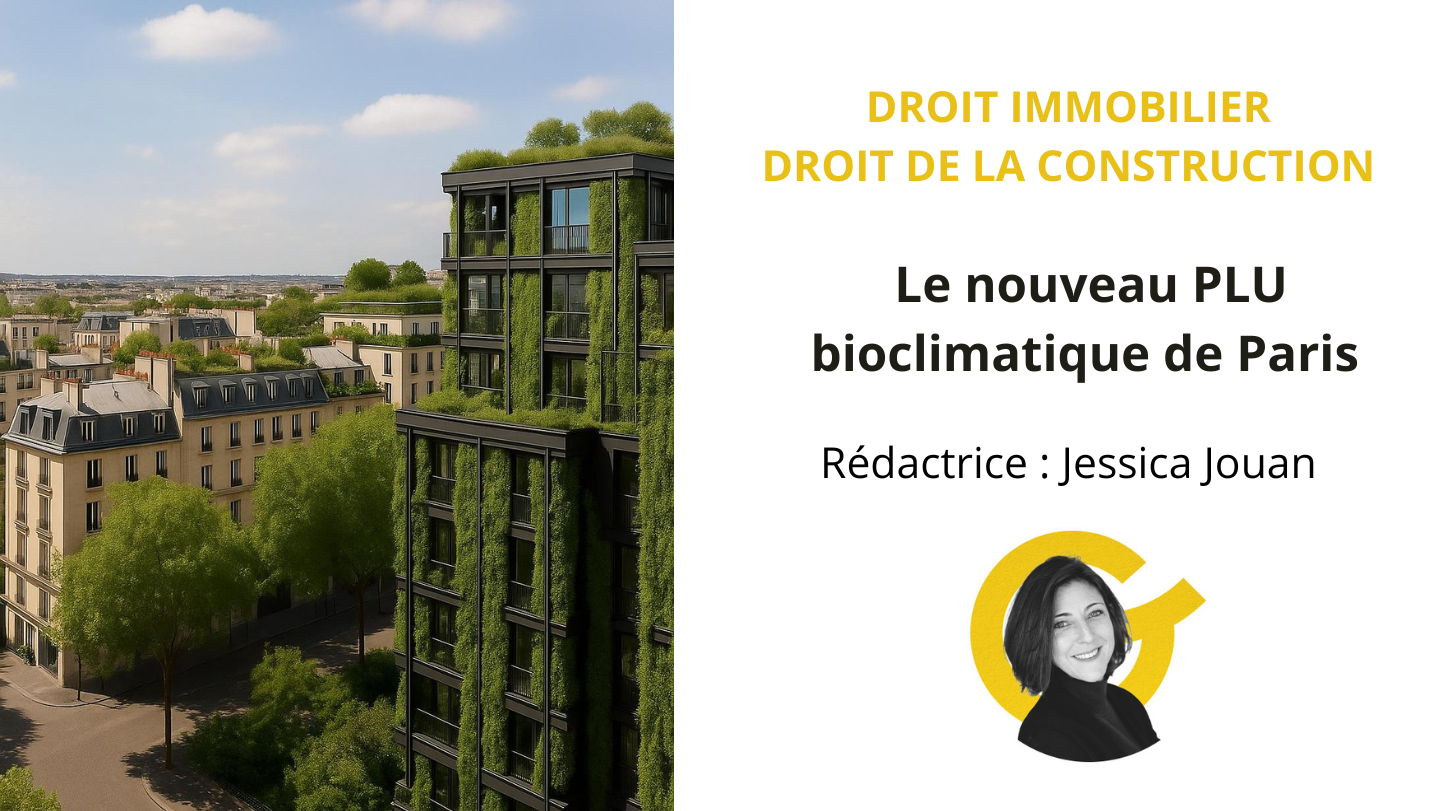
Nouveau PLU de la ville de Paris
Un défi pour l’immobilier, une opportunité pour les acteurs engagés.
⊕ Fin novembre 2024, Paris a franchi une étape décisive en adoptant le premier Plan Local d’Urbanisme bioclimatique (PLU-b) de France. Pensé comme un instrument au service de la transition écologique, de la mixité sociale et de l’adaptation au changement climatique, ce nouveau cadre réglementaire transforme en profondeur la manière de concevoir, construire, rénover et valoriser l’immobilier dans la capitale.
⊕ Ce texte a suscité de nombreuses critiques dans la profession, notamment en raison des contraintes supplémentaires qu’il impose aux opérations immobilières. Pourtant, il serait réducteur de s’y arrêter. Le PLU-b constitue aussi une opportunité de renouvellement, de création de valeur durable et d’innovation. En tant que professionnels du droit et de l’urbanisme, notre rôle est aussi d’aider nos clients à identifier et exploiter ces leviers.
⊕ Nous vous proposons ici une lecture double : celle d’un cadre exigeant à appréhender, et celle d’un terrain fertile pour bâtir la ville de demain.
Sommaire :
I. LE PLU BIOCLIMATIQUE : UN NOUVEAU CADRE EXIGEANT
1.1. Un changement de paradigme dans les normes de construction
1.2. L’Urbascore et les externalités positives
1.3. Un urbanisme plus végétal… et contraignant
1.4. La mixité sociale renforcée : le « pastillage »
II. UN LEVIER D’INNOVATION ET DE VALORISATION
2.1. Des zones de développement à fort potentiel : les quartiers prioritaires de ville (QPV)
2.2. Un cadre favorable aux partenariats public-privé
2.3. Une dynamique économique et foncière nouvelle
I. LE PLU BIOCLIMATIQUE : UN NOUVEAU CADRE EXIGEANT
1.1. Un changement de paradigme dans les normes de construction
Le premier défi posé par le PLU-b réside dans le durcissement net des règles de construction. Toute opération de plus de 150 m² doit désormais intégrer une démarche dite « bioclimatique », qui repose sur la valorisation des conditions environnementales locales (orientation, ensoleillement, ventilation naturelle…) pour limiter les besoins énergétiques.
Les constructeurs devront recourir à des matériaux à faible empreinte carbone comme le bois, la pierre ou les isolants biosourcés, reléguant le béton traditionnel à un usage marginal. Par ailleurs, le recours à la climatisation devient l’ultime solution, à n’envisager qu’après l’épuisement des solutions passives. Ce bouleversement implique une révision des pratiques pour les maîtres d’œuvre, les entreprises de construction et les promoteurs.
1.2. L’Urbascore et les externalités positives
Le PLU-b introduit également un système inédit d’évaluation de la qualité environnementale des projets, appelé Urbascore. Toute construction neuve ou restructuration lourde devra démontrer qu’elle génère des « externalités positives » — c’est-à-dire des bénéfices pour l’environnement et la société — dans au moins deux des trois thématiques (biodiversité, programmation, sobriété énergétique).
Il ne s’agit plus simplement de respecter la réglementation : il faut maintenant faire preuve d’un surcroît de qualité environnementale pour obtenir son autorisation d’urbanisme. Cette exigence, bien qu’ambitieuse, nécessite une anticipation rigoureuse des projets et des compétences nouvelles, notamment en ingénierie verte.
1.3. Un urbanisme plus végétal… et contraignant
Autre transformation majeure : la place accordée à la végétalisation. Le PLU-b impose désormais un minimum de pleine terre sur chaque parcelle, parfois jusqu’à 65 % dans certains cas, et interdit toute imperméabilisation de sol sans justification. Les toitures végétalisées deviennent la norme, les cours d’immeubles doivent être perméabilisées et des arbres plantés pour réguler les îlots de chaleur.
Pour les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment ayant une emprise au sol de plus de 500 m², celles-ci doivent ainsi intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Ce pourcentage sera porté à 40 % en 2026, et à 50 % en 2027.
Plusieurs typologies de bâtiments sont concernées (commercial, industriel, artisanal ou administratif, bureaux, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, sportifs, récréatifs et de loisirs, scolaires et universitaires).

Ces mesures, qui visent à répondre à une exigence écologique, peuvent sensiblement réduire la surface potentiellement constructible (ou aménageable, en toiture accessible), voire remettre en question des équilibres financiers délicats. Insérer dans la promesse de vente une condition suspensive liée à l’atteinte d’un ratio de surface plancher viable permet de sécuriser l’opération.
II. UN LEVIER D’INNOVATION ET DE VALORISATION
2.1. Des zones de développement à fort potentiel : les quartiers prioritaires de ville (QPV)
L’un des aspects les plus prometteurs du PLU-b tient à l’identification de zones de développement prioritaire. Ces secteurs, souvent situés en périphérie de l’hypercentre ou dans les anciens tissus industriels, sont destinés à accueillir des projets ambitieux en matière de logements, d’activités, d’équipements publics ou de végétalisation.
Parmi les secteurs identifiés figurent Bercy-Charenton (12e arrondissement), la ZAC Clichy-Batignolles (17e), la Porte de Montreuil (20e) ou encore le quartier Chapelle Charbon (18e). Ces territoires font l’objet d’une attention particulière de la ville de Paris, avec des incitations à densifier, réhabiliter ou transformer des friches en quartiers mixtes, verts et dynamiques.
Pour un promoteur ou un investisseur, ces zones sont synonymes de potentiels fonciers à forte valeur ajoutée, avec des marges de manœuvre architecturales et urbanistiques plus larges. Des opérations de surélévation, de réaffectation de bureaux en logements ou de reconversion d’anciens sites industriels y sont favorisées. Ces opérations bénéficient en outre de régimes fiscaux avantageux et peuvent être intégrées dans des dispositifs de subventions ou d’exonération de la taxe d’aménagement.
Paris propose ainsi plusieurs dispositifs fiscaux ciblés visant à encourager l’investissement économique et immobilier, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ces mesures constituent des leviers importants pour optimiser la rentabilité des projets et faciliter leur acceptabilité sociale.
Par exemple, les entreprises qui s’implantent ou se développent dans les QPV à Paris peuvent bénéficier d’une exonération totale de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant cinq ans, puis d’un abattement dégressif les trois années suivantes : 60 % la 6e année, 40 % la 7e, et 20 % la 8e. Cette mesure s’applique aux entreprises de moins de 250 salariés respectant certaines conditions de chiffre d’affaires. Les très petites entreprises peuvent également bénéficier d’une exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant cinq ans. Et les bailleurs sociaux d’un abattement de 30 % sur cette même taxe.

Si les périmètres de mutation peuvent sembler attractifs, des contreparties peuvent toutefois être exigées (cessions gratuites, équipements publics, clauses anti-spéculatives). Mieux vaut les intégrer au bilan dès l’offre d’achat.
2.2. Un cadre favorable aux partenariats public-privé
Le PLU-b s’inscrit dans une logique de coproduction de la ville. À travers des outils comme les Projets Urbains Partenariaux (PUP) ou des montages innovants comme le Bail Réel Solidaire (BRS), la ville de Paris cherche à associer promoteurs, investisseurs, aménageurs et bailleurs sociaux dans une dynamique de partage de valeurs et de responsabilités.
Le Projet Urbain Partenarial (PUP), par exemple, permet à un promoteur de co-financer des équipements publics (voiries, espaces verts, écoles) en contrepartie d’un allègement ou d’une exonération de la part communale (5%) de la taxe d’aménagement pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. Les parts départementales et régionales restent toutefois dues. La convention de PUP, négociée avec la collectivité, définit les engagements de chaque partie, notamment en matière de cofinancement des équipements publics.
C’est un outil contractuel particulièrement adapté dans les zones de développement intensif et déjà expérimenté dans plusieurs secteurs pilotes, notamment dans les 13e, 18e et 20e arrondissements (PLU – Annexes – Projets urbains partenariaux — Paris Data).
Le Bail Réel Solidaire (BRS), quant à lui, dissocie le foncier du bâti : la ville ou un organisme foncier solidaire reste propriétaire du terrain, tandis que l’acquéreur devient propriétaire du logement pour un coût réduit, dans un cadre encadré. Ce montage permet d’offrir de l’accession à la propriété abordable à Paris, tout en garantissant la pérennité de l’usage social du bien.

Les clauses de réversabilité ou d’indexation foncière insérées dans certains PUP ou BRS peuvent néanmoins fragiliser la rentabilité du montage. Il est souvent judicieux de les identifier et de les discuter en amont du dépôt du permis de construire, tant que les marges de négociation existent encore.
2.3. Une dynamique économique et foncière nouvelle
Certes, les exigences techniques augmentent les coûts initiaux. Mais à plus long terme, les projets conformes au PLU-b devraient bénéficier d’un effet de valorisation : meilleure image auprès des usagers et des élus, attractivité pour des acquéreurs soucieux de l’impact environnemental, facilités d’accès au financement durable.
Iii. BATIR AVEC LE PLU, PAS CONTRE LUI
Le nouveau PLU bioclimatique de Paris ne signe pas la fin des projets immobiliers, mais plutôt leur nécessaire mutation. Il impose un saut qualitatif — environnemental, social, architectural — auquel il faut se préparer avec rigueur, créativité et méthode.
Pour les promoteurs, maîtres d’œuvre, investisseurs et gestionnaires d’actifs, ce plan n’est pas qu’un carcan. Il est aussi un catalyseur de projets innovants, exemplaires et rentables à moyen terme. Il appelle des montages plus fins, des stratégies foncières renouvelées, un dialogue renforcé avec les collectivités… et un accompagnement juridique à chaque étape.
Notre cabinet est pleinement mobilisé pour vous aider à transformer cette réglementation ambitieuse en projets solides, sécurisés et attractifs. N’hésitez pas à nous solliciter pour une analyse de vos opérations, une mise en conformité stratégique ou le montage d’un partenariat public-privé.

